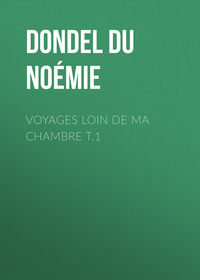Kitobni fayl sifatida yuklab bo'lmaydi, lekin bizning ilovamizda yoki veb-saytda onlayn o'qilishi mumkin.
Kitobni o'qish: «Voyages loin de ma chambre t.1»
AVANT-PROPOS
—
Et maintenant que je suis vieille, j’aime à conter ce que j’ai fait.
Xavier de Maistre s’est contenté de sa chambre pour y faire jadis des expéditions diurnes et nocturnes, demeurées célèbres, mais il fallait l’esprit du grand écrivain pour raconter sur place ce fantaisiste voyage. D’ailleurs, ce genre d’excursion ne peut s’entreprendre qu’une fois; ce n’est donc point autour mais hors de ma chambre et très loin d’elle que j’ai voyagé.
Les voyages ont cela d’agréable, qu’ils intéressent le lecteur en l’instruisant. La vérité reste supérieure à la fiction, si charmante qu’elle soit, et les récits vrais d’un beau voyage l’emporteront toujours sur n’importe quel roman.»
«Lisons, mais lisons de bons livres. Aujourd’hui ce n’est pas seulement le goût littéraire, c’est bien plus encore, c’est le sens moral qui est en péril.»
—
SOUVENIRS DE VOYAGE
de Novembre 1870 à Juillet 1871
A Mme Zoé Talbot, née Allenon de Grandchamp.
CHAPITRE I
Départ pour la Suisse
Je quitte Vannes demain, 3 novembre, avec ma petite Georgette, je vais passer quelques jours dans ma famille. Je vais lui dire adieu avant de la quitter. Je pars effrayée du présent, inquiète de l’avenir! Reverrai-je ce petit coin de terre où j’ai vécu longtemps déjà? Reverrai-je mes parents, mes amis, ma maison, le sweet home, avec tous ses objets intimes et familiers qui vous font retrouver la vie vécue, où vous apercevez accrochés dans tous les coins vos plus chers souvenirs, tristes ou gais? Telles sont les pensées mélancoliques qui se mêlent aux apprêts du départ.
Saint Jérôme n’a-t-il pas dit: «La douleur qu’on éprouve en quittant ses amis est proportionnée à l’amour qu’on leur porte. Tantus dolor in amittente quantus amor in possidente.»
Aussi, comme mon pauvre cœur est troublé! mais n’importe, la France est bouleversée, un ennemi vainqueur et cruel l’enserre de toute part. Il arrivera pire peut-être. La guerre civile peut succéder à la guerre étrangère, mieux vaut être au loin à ces heures fatales… d’ailleurs, deux femmes seules, une mère et sa fillette ne peuvent être d’aucun secours pour la Patrie…
Le 10 novembre, je monte avec Georgette dans l’omnibus de Ploërmel, qui conduit à la gare de Questembert. Malgré ma tristesse, je me sens disposée à tout voir, à tout admirer, à m’abandonner au charme du nouveau, de l’inconnu.
Oh! les belles fougères qui bordent la route, ce sont les seules verdures maintenant; cependant, en voilà beaucoup que la gelée a cuivrées d’abord, teintées de feu ensuite. Elles vont mourir. Les arbres aussi sont dépouillés!
Je me penche souvent à la portière pour apercevoir encore ce pauvre et cher petit Ploërmel, d’où datent mes plus lointains souvenirs d’enfance.
Mes compagnons de voyage sont insignifiants, je m’absorbe dans mes pensées où les regrets et l’appréhension marchent en se coudoyant. Georgette est enchantée de la locomotion, mais comme à son âge on se fatigue vite de la même chose, je l’ai munie de quelques friandises qui lui seront une ressource contre l’ennui.
A Questembert, nous montons dans le train avec un vieux monsieur qui me fait songer au Juif-Errant: il en a assez l’extérieur, et me raconte qu’il vient de parcourir les villes de l’Est. Le voici à l’Ouest, et il parle de se diriger vers le centre. Nous le perdons à Nantes, mais le retrouvons au buffet de Tours, le lendemain matin à six heures; le temps est affreusement froid, la neige commence à tomber. Là, nous montons encore dans le même wagon et continuons notre voyage pêle-mêle, avec des soldats de toutes armes, dont quelques-uns sont blessés. Un turco réclame, en me tutoyant, mes soins pour panser sa blessure. Je me hâte de témoigner ma sympathie à ce héros obscur, à ce bon enfant de l’Afrique, qui pleure au souvenir de son pays, et de ceux qu’il a laissés là-bas. En reconnaissance de ce que je fais pour lui, il tire du fond de ses grandes poches des pommes et des morceaux de sucre qu’il offre à Georgette, s’excusant de n’avoir rien de meilleur, et nous avons toutes les peines du monde à lui faire garder ses petites douceurs qui lui sont nécessaires et dont il veut se priver pour nous. Sous son enveloppe basanée et rigide, bat un cœur généreux. Louis XVII, dans sa sombre prison du Temple, n’avait-il pas gardé la plus belle des deux pommes, que la Simon lui jeta un jour en pâture, pour la donner au médecin qui venait le soigner.
La délicatesse de sentiments est de toutes les conditions.
Les belles campagnes de la Loire m’apparaissent ensevelies dans les neiges. Comme tout ce pays doit être beau l’été, coteaux couverts de vignes, noyers chevelus, rivières argentées, prairies verdoyantes, châteaux princiers. Quelle richesse! c’est bien là le jardin de la France. A Vierzon, l’aspect change. Le pays devient triste et pauvre, ici disparaît notre compagnon biblique. Nous subissons un long arrêt de quatre heures, la gare est encombrée de militaires aux uniformes les plus variés et les plus fantaisistes, j’y vois des francs-tireurs en grand nombre, tout ce monde va rejoindre le gros de l’armée de la Loire et se dirige vers Bourges.
Bourges, que nous saluons seulement au passage, est dans une situation délicieuse. Arrivés à Saincaize très tard, nous nous installons, après un maigre et très cher souper au buffet, dans la salle d’attente pour trois ou quatre heures, et chacun dort comme il peut.
Vers trois heures du matin, il faut se réveiller piteusement pour prendre la ligne de Dijon, nous entrevoyons vaguement Moulins, Roanne blanchis de neige, et nous entrons dans les montagnes de la Côte-d’Or, avec des tunnels à n’en plus finir et des chalets pittoresquement situés, qui font déjà rêver à la Suisse. La campagne est splendide aux environs de Lyon. Nous y arrivons à onze heures du matin, nous avons trois heures d’arrêt, tâchons de les bien dépenser. Je descends bravement en ville, et m’aventure jusqu’à la place Bellecour.
Si ce n’était le drapeau rouge qui flotte à l’Hôtel-de-Ville, et les proclamations séditieuses qui tapissent tous les murs, on pourrait croire que la ville est calme. Nous prenons la ligne de Genève vers deux heures, franchissons le Rhône majestueux, puis la Saône.
Ah! quel admirable fleuve que le Rhône! On devrait écrire l’histoire des fleuves, comme on écrit celle des hommes. N’est-ce pas sur leurs bords riches et féconds que s’élèvent les plus belles cités, et ne se trouvent-ils pas ainsi entièrement liés à l’histoire des peuples?
Le Rhône est le plus beau des fleuves de l’Occident.
«C’est, par excellence, le fleuve historique de l’Europe. S’ouvrant sur la Méditerranée, la mer classique du monde ancien, et directement orienté vers le nord, le Rhône était destiné à devenir le grand chemin des nations. C’est par lui qu’ont pénétré tour à tour les Phéniciens, les Grecs, les Romains, et avec eux tous les arts, tous les cultes, tous les conquérants, tous les trafiquants de la Méditerranée. C’est sur ses rives que se sont passés les évènements les plus décisifs de notre histoire.»
Bientôt nous n’avons plus qu’un horizon de montagnes. Ici commencent mes étonnements, mes exclamations; le train marche fort lentement, les tunnels font le bonheur de Georgette et mon désespoir. A Culoz, embranchement pour Aix-les-Bains, j’ai envie d’y aller coucher, et fais d’inutiles tentatives pour faire changer de direction à mes bagages, impossible d’y parvenir; il faut renoncer à voir ce beau lac du Bourget, qui a si bien inspiré Lamartine, et repartir pour Genève. Nous remontons en wagon, l’heure avance, les voyageurs descendent peu à peu, et nous restons seules dans notre compartiment, Georgette dort paisiblement, moi j’ai trop envie de voir autour de moi pour y songer. A Bellegarde, dernière station française, encore longue attente, visite des passeports, il fait noir comme terre. Au moment où le train va se remettre en mouvement, un grand jeune homme, à barbe fauve, avec un large manteau, escalade la portière de notre wagon et se promène avec agitation de long en large. Je vois dans mon guide que nous allons entrer dans le tunnel du Credo, long de treize cents mètres, le train suit des courbes effrayantes, je n’ai encore rien vu de pareil, ce ne sont que précipices à droite et à gauche, et j’ai de sinistres pressentiments. Le grand jeune homme fauve cherche à lier conversation et à me faire admirer les belles horreurs qui nous environnent, mais je refuse obstinément de mettre la tête à la portière, même pour regarder les chutes du Rhône, croyant deviner que ce sera le moment fatal où le brigand me plongera entre les deux épaules, le poignard qui doit être caché sous son manteau. Je n’ai d’yeux que pour suivre chacun de ses mouvements, ce qui donne peut-être une autre direction à ses idées et lui fait croire de ma part à une sympathie spontanée.
J’ai tout lieu de m’arrêter à cette supposition, car au bout d’une demi-heure, il essaie de me témoigner que la sympathie est réciproque. Enfin, vers onze heures nous arrivons sains et saufs à Genève, où mon inconnu s’empresse de me chercher une voiture et de me rendre quelques menus services. Nous nous quittons fort poliment, mais jamais je n’oublierai les dangers imaginaires que j’ai couru de Bellegarde à Genève.
CHAPITRE II
Genève, Chamounix, le Mont-Blanc, le lac Léman, Evian, Chillon, Lausanne
A Genève, nous descendons à l’Hôtel de la Balance, rue du Rhône, hôtel assez confortable, mais la maison est pleine et nous avons en partage une mauvaise chambre, où je trouve bien difficile de dormir. Notre première sortie est pour aller entendre la grand’messe à la nouvelle église catholique; la reine d’Espagne et sa fille y étaient ce jour-là. Puis nous allons faire une promenade en voiture autour de la ville. Je suis ravie de Genève, j’admire son beau lac et son cadre de montagnes dominées par le Mont-Blanc, ensuite nous visitons plus en détail l’intérieur de la ville, la vieille cathédrale, le musée, le jardin anglais tout au bord du lac, avec un relief du Mont-Blanc, l'île Jean-Jacques Rousseau, enfin toutes les curiosités de cette belle cité, l’une des plus éclairées et des plus industrieuses qui existent.
Mais je l’avoue, le Mont-Blanc et le lac sont mes deux objectifs de prédilection. Le voilà ce beau lac Léman, aux poissons exquis, aux demeures enchantées, aux sites féeriques, montagnes vertes, glaciers éblouissants, ce lac de saphir, qui connaît cependant les tempêtes, les crues subites et que le Rhône majestueux lui-même toujours, traverse sans mêler ses eaux aux siennes.
Le voilà ce lac suisse, rempli de souvenirs français; c’est le lac de Jean-Jacques Rousseau et de Mme de Warens, de Mme de Staël et de lord Byron. Monabri parle de Mgr Dupanloup comme Evian parle de Montalembert, et Montrieux du père Gratry: «Grandes âmes catholiques venant sur une terre en partie protestante, attirées là sans doute par la souriante image de St-François de Sales.»
Genève est donc une ville superbe, ses habitants sont serviables et polis; voilà mon sentiment, aussi je renie ce méchant jeu de mot de l’un de ses habitants, quelque peu rageur sans doute:
«Quand je ne vois
Que Génevois
Rien de bon je ne vois.»
Je songe aussi à faire usage de mes lettres de recommandation et dans cette patrie d’adoption de Calvin, considérée autrefois comme la Rome du calvinisme, j’ai l’honneur d'être reçue par Monseigneur Mermillod, évêque auxiliaire de Genève et Lausanne et l’un de nos prélats catholiques les plus éminents. Il a des manières extrêmement paternelles et bienveillantes. C’est ainsi que je me suis toujours représenté un évêque, vrai pasteur du troupeau des âmes.
Je n’ai pas voulu quitter Genève sans faire une promenade à la belle vallée de Chamounix. Là, tous les honneurs sont pour Sa Majesté le Mont-Blanc, le sommet le plus élevé des Alpes pennines et de toute l’Europe. Il a quatre mille huit cent dix mètres au-dessus de la mer. Il faut deux jours pour le gravir, Saussure est le premier qui en ait fait l’ascension en 1787; il a eu depuis bien des imitateurs. Quant à moi, j’ai refusé énergiquement l’alpenstock, le bâton de l’ascensionniste, et je me suis contentée de saluer d’en bas et très bas le géant, sans vouloir faire avec lui plus intime connaissance. C’est aussi à distance que j’ai admiré les immenses glaciers, formés des eaux qui descendent du Mont-Blanc.
«Ces amas de blocs énormes, frangés de nappes éblouissantes, produit des brisures incessantes de la masse de neige accumulée entre les pics rocheux, premiers degrés du Mont-Blanc sont fixés autour de lui comme des sentinelles gigantesques.»
Tout cela c’est le chaos, mais d’une sublime grandeur qui saisit l’esprit. C’est également de loin que j’ai salué très respectueusement la mer de glace.
Ah! cette mer de glace, qui a près de huit kilomètres, quel effarement pour ceux qui n’ont pas le pied… montagnard et ne connaissent comme moi que le vulgaire plancher des vaches.
Cette mer de glace, c’est une frappante image de la vraie mer. Les flots de glace sont presque aussi dangereux que les flots d’eau. Les glaciers sont unis, ce sont des miroirs, mais la mer de glace est tourmentée et combien devient dangereuse la traversée de cette mer, sur la crête immobile de ces vagues d’eau pétrifiée! C’est armé d’un bâton en sapin ferré d’un crampon solide que l’on commence cette marche unique dans son genre.
On n’écoute pas assez les bons conseils des guides; quoique toujours prêts à secourir les imprudents et les inhabiles, ils ne peuvent pas tous les sauver. La témérité et la maladresse se paient parfois trop cher, il arrive bien des accidents.
Ces flots entassés non sans ordre, vous apparaissent comme des flots marins, dont ils ont la couleur et la transparence, ils font penser à une mer soulevée par la tempête, malgré leur immobilité, malgré leur coupure en crevasses profondes, dont l'œil ne peut essayer de mesurer les dimensions abîmières, malgré les glissoires verticales, qui ont jusqu’à trois cents mètres, et plus, de profondeur et qui aboutissent à d’effroyables gouffres.
Sur ces hauteurs, à peine accessibles, on a la notion complète du silence absolu.
Sur la mer, si douce qu’elle soit, les vagues clapotent; dans les bois, la brise murmure; aux champs on entend la rumeur, le fourmillement des infiniment petits. Ici rien, aucun bruit sous le ciel d’un bleu sombre, aux reflets aciérés.
Quand le soleil irradie ces pics sauvages, dont le front semble crever le ciel et dont les pieds sont entourés de radieux mirages, l’effet est saisissant. C’est une vision fantastique, éblouissante, qui s’incruste à jamais dans la mémoire.
Du reste, Alexandre Dumas a si bien décrit ce pays en disant tout et même plus que ce qu’on en peut dire, qu’il ne reste rien pour les humbles comme moi qui n’ont ni son étonnante imagination ni son talent fertile.
Il en est de même du voyage en Orient de Lamartine. Tous ceux qui ont refait ce voyage après lui, officiers de marine, peintres, écrivains, ont vainement cherché les lieux témoins de ses merveilleuses descriptions. C’était le poète qui voyait les choses, c’était la magie de son imagination qui colorait tout cela, c’était son propre idéal qu’il traduisait. D’ailleurs, je suis fatiguée de mon excursion, la bête en ce moment l’emporte sur la belle. Je ferme mon cahier et je mets ma plume et mon esprit au repos.
Après avoir fait d’inutiles tentatives pour trouver un petit logement à mon gré, Mgr Mermillod me conseille d’aller à Evian, la perle du lac, à trois lieues environ de Genève, et me donne une lettre de recommandation pour l’aumônier du couvent de Saint-Joseph. Nous traversons donc le lac en bateau à vapeur. Cette petite traversée m’a semblé délicieuse. A Evian, nous nous rendons tout droit chez le bon aumônier, vrai Saint François de Sales rustique à qui j’abandonne le soin de me caser, mais au bout de quelques jours, je vois bien qu’il me sera impossible de rester à Evian, malgré son site enchanteur: le manque de journaux est pour moi une grande privation, en ce moment on ne vit pas seulement de pain, il faut des nouvelles, que devient notre chère et malheureuse France?
Ah! que Victor Hugo avait bien raison le jour où il a dit: Pour aimer votre patrie, quittez-la… Sa pensée me revient sans cesse, et n’en entendre plus parler me semble un vrai supplice.
Nous partons au bout d’une semaine pour le Bouveret à l’extrémité Sud-Est du lac en passant par Saint-Gingolph et les rochers de Meillerie.
Là, nous prenons la ligne du chemin de fer d’Italie jusqu’à Saint-Maurice, petite ville du Valais enfouie au pied de hautes montagnes, dont la principale est la Dent du Midi. Ce lieu pittoresque me plaît beaucoup, mais ma fièvre de curiosité ne me permet pas de me poser encore. Il faut que je voie toutes ces charmantes villes qui bordent le lac: Villeneuve, Aigle, Bex aux eaux sulfureuses et aux mines de sel gemme, Montreux, Vevay avec sa halle au blé à colonne de marbre, Chillon avec son château fort d’un grand effet sur son rocher isolé. Ce château servait jadis de prison d’Etat, et renferma pendant quatre ans le fameux patriote et célèbre historien protestant Génevois Bonivard, dont les malheurs ont inspiré à Lord Byron l’un de ses plus beaux poèmes.
Nous avons visité l’appartement qu’occupa le prisonnier, nous avons vu l’empreinte creusée dans le roc par ses chaînes. Un reflet du ciel tombant bleuâtre et terne, à travers l’étroite fenêtre grillée, répandait à ce moment sur le sol les teintes d’azur changeant qui rendent si mélancoliques les demeures souterraines du château de Chillon. C’est sur le bord de cette fenêtre, dit la légende, qu’un petit oiseau venait chanter chaque jour et consoler le prisonnier.
Les indigènes montrent aussi aux amateurs de souvenirs authentiques, les traces des pas de ce «martyr du papisme» qui aurait dit après sa délivrance: «J’avois si bon loisir de me pourmener, que je empreignis un chemin à la roche qui étoit le pavement de céans comme si on l’eût fait avec un martel.»
J’avoue qu’au premier moment j’avais trouvé cela un peu fort: les pas de Bonivard creusant une empreinte ineffaçable dans la roche dure en si peu d’années, puis je n’y avais plus pensé.1.
Nous avons terminé par Lausanne, où je dois rendre visite au curé catholique pour lequel j’ai une lettre de recommandation. Ah! Lauzanne, quelle ville glaciale, quelle Sibérie! Elle n’aura pas nos préférences. Nous courons chez notre curé qui nous reçoit à merveille, nous fait nous chauffer et nous réconforte de son mieux. Vraiment, nous en avions grand besoin, car je ne me rappelle pas avoir jamais eu aussi froid. Pauvre Georgette en pleurait, le vent lui avait enlevé son chapeau, et nous nous demandions s’il n’allait pas nous emporter nous-mêmes; c’est devenu une vraie course que de rattraper ce chapeau qui s’envolait chaque fois que nous croyions mettre la main dessus.
Avec les indications du bon curé, je suis allée voir quelques logements, mais je n’ai rien trouvé qui me convînt, et je crois que ce froid terrible m’indispose contre Lauzanne malgré sa délicieuse situation. Après avoir parcouru la ville en tous sens, nous prenons le train du soir pour Fribourg.
CHAPITRE III
Fribourg, le Moléson, Gruyères
J’ai le pressentiment que c’est à Fribourg que je m’arrêterai. Nous descendons à l’hôtel des Merciers, tout près de la vieille cathédrale Saint-Nicolas. Ce matin j’ai parcouru la ville. Quel aspect étrange! Avec ses terribles vieilles tours posées en sentinelles, et les fenêtres de ses maisons ornées de riches et lourdes grilles en fer, elle a conservé le cachet moyen-âge. La cathédrale possède une chaire et un baptistère en pierre sculptée qui sont remarquables, ainsi que la magnifique grille séparant le chœur de la nef.
Elle possède aussi les célèbres orgues d’Aloys Mooser. Au dire des Fribourgeois, qui en sont très fiers, ce grand orgue est comme celui de Harlem, en Hollande, une véritable merveille. A lui seul, il mérite le voyage de Fribourg.
On m’a fait remarquer sur la petite place, le vieux tilleul de Morat; son grand âge et le glorieux souvenir qu’il rappelle, le rendent l’objet d’un culte tout particulier de la part des habitants, moi je ne l’ai pas regardé du même œil, il m’a rappelé la victoire des Suisses sur les Français, et quoique cela remonte loin, cette vieille défaite du passé, en ce moment où nous en comptons tant dans le présent, m’a jeté du froid dans l'âme. Quand l'âme souffre, que ce soit celle de la Patrie ou des individus, elle voit partout des allusions à ses propres malheurs.
Voici la légende de ce tilleul:
Un jeune guerrier apportait à Fribourg la grande nouvelle de la victoire remportée à Morat sur Charles-le-Téméraire, en 1476. Il tenait en main une branche de tilleul, mais épuisé par le combat et la course, il tombe et meurt en arrivant. C’est sur l’endroit même où il rendit l'âme qu’on planta son rameau de tilleul, qui est devenu l’arbre vénérable et quatre fois séculaire, que je viens de contempler.
C’est sur l’emplacement de l’ancien château du duc Zaehringen Berthold IV, margrave de Bade, fondateur de Fribourg, que s’élève l’hôtel de ville.
Une partie de la cité fribourgeoise est bâtie sur des rochers à pic, l’autre partie au pied de ces rochers, sur les bords de la Sarine. Pour communiquer de la ville haute à la ville basse, il faut descendre des escaliers couverts interminables placés quelquefois sur le toit des maisons de la partie inférieure.
Ses deux ponts, d’une élévation prodigieuse, suspendus l’un sur la Sarine, l’autre sur l’étroite et profonde vallée du Gotteron sont vraiment jetés au-dessus de deux abîmes. Il y a beaucoup d’anciennes églises curieuses à visiter et plusieurs vieux monastères aux environs de la ville; ces monuments d’un autre âge, sont pour le voyageur une agréable vision du passé; la charmante petite chapelle de Notre-Dame-de-Lorette plantée au sommet d’un rocher à pic, tout au bord de la Sarine, retient aussi les touristes: elle fut construite en 1647, d’après le modèle de la Casa Sancta, et renferme de nombreux et très curieux ex-voto. Les orgues sont aussi d’Aloys Mooser.
De ce point élevé, on jouit d’un magnifique panorama. A l’ouest on voit les monts du Jura, au sud le Moléson, et la vallée de Gruyères, célèbre par ses fromages appréciés du monde entier.
Décidément, Fribourg me plaît; nous allons y installer nos quartiers d’hiver, je viens de louer un appartement chez M. de Fiwaz, zélé catholique, ancien défenseur du pape et de Ferdinand VII. Grâce à ses conversations intéressantes sur la Suisse et l’Italie, je ne m’ennuierai pas trop ici. Ce bon Suisse ainsi que la plupart de ses compatriotes témoigne d’une grande sympathie pour la France, il me procure des journaux autant que j’en puis lire, et je suis parfaitement au courant des nouvelles de la guerre. Son désir de m'être agréable en tout est si évident, il a tant de prévenances pour ses deux Françaises que je lui pardonne ses politesses un peu exagérées, qui ne vont point à son excellente et simple nature. Georgette et lui sont une paire d’amis, il va tous les jours la conduire à l’école, la tenant cachée sous son immense pelisse de fourrure. C’est ainsi qu’ils font presque toutes leurs promenades; petits souliers et grandes bottes, trottant sous le même manteau.
Grâce à M. Fiwaz, nous avons assisté hier à un petit spectacle fort réjouissant. Nous avons entendu trois Jodler d’Apenzell en costume national. Ces troubadours modernes portent la culotte jaune, la veste rouge, des boucles d’oreilles et des médaillons féminins au cou. Leur chemise est attachée par des boutons plats en argent. Une courte pipe est suspendue à leur boutonnière; le fameux Ranz des Vaches a clos la séance. Nous avons écouté religieusement cet air populaire dont l’audition inspirait jadis aux mercenaires de l’Hélvétie une nostalgie si vive qu’ils n’hésitaient pas à déserter dès qu’ils en avaient entendu les premières mesures. Un petit incident est venu rompre le charme, nos artistes même, en chantant, n’avaient point lâché leur énorme pipe de porcelaine, et l’un d’eux au beau milieu de son exécution s’est arrêté pour la rallumer, en battant le briquet suivant l’antique usage de l'âge de pierre. Je n’ai pas osé rire, mais j’en avais bien envie.
Je suis toujours au premier chapitre de mes étonnements et de mon admiration, je ne me fatigue pas du spectacle grandiose des montagnes. Comment décrire ces masses abruptes, farouches, toutes noires avec leur capuchon de neige, les pics, colosses fantastique, les gouffres, abîmes sans fond, les clameurs sinistres des torrents, la plainte affolée du vent, comment décrire tout cela entendu et vu quand la nuit bat son plein, que le silence enveloppe la terre sous les ruissellements d’un ciel plein d’étoiles? Quelle fascination! cette contemplation muette, c’est une prière, et vous vous sentez troublé jusqu’au plus intime de votre être. Le touriste avide d’émotions suggestives, de sensations neuves, fera bien aussi d’aller voir un lever de soleil dans les montagnes. C’est quelque chose de féerique que ni la parole ni la plume ni même le pinceau ne peuvent rendre.
«Frangé d’or, l’horizon s’embrasait; et, le soleil, lentement comme s’il eût hésité à prendre son essor dans l’immensité radieuse dont il colorait les nuées des milles couleurs du prisme, cernant de rouge et de vert de bleu et de jaune, de violet et de rose les contours de ces îles aériennes, archipel merveilleux jeté en l’azur du firmament infini, le soleil incandescent et infixable dans son éblouissante ascension, montait majestueux au milieu des astres soudainement évanouis… Sur les monts la lune s’éteignait…»
Quand le temps le permet, je pérégrine volontiers avec M. Fiwaz, il me donne toutes les explications voulues, à l’aide de ses connaissances historiques et géographiques, je m’instruis, et nos promenades me semblent très attrayantes. J’ai consenti à faire à dos de mulet l’ascension du Moléson, à deux mille mètres d’altitude. C’est ma première ascension… je crois bien que ce sera aussi ma dernière. Vue splendide, fatigue intense… je ne sais lequel l’emporte sur l’autre. Du sommet du Moléson, on découvre les lacs Léman, Neuchâtel, Morat et Bienne, les villes d’Evian, Thonon, une partie de Genève, Morges, Romont, Neuchâtel, Morat, Fribourg, une partie de la Savoie et du Jura français et suisse.
Je suis aussi allée à Gruyères, une petite ville à sept lieues de Fribourg, bâtie sur un monticule. Elle s’enorgueillit de son antique château, résidence des comtes de Gruyères du neuvième au seizième siècle. Elle a deux industries: le tressage de la paille et principalement la fabrication du fromage, qui s’étend dans toutes les campagnes.
Je soupçonne M. Fiwaz d’embellir un peu ses récits. Il m’a raconté que dans le petit village de Zermatt, station des Alpes valaisanes, il y a une aristocratie constituée d’après un principe très particulier: les quartiers de noblesse sont des quartiers… de fromage.
Les familles de Zermatt sont d’autant plus nobles qu’elles possèdent plus de fromages et de plus anciens; certains datent d’avant la Révolution française; leurs propriétaires forment la haute aristocratie du pays.
Les fromages jouent un rôle très spécial dans la vie sociale de Zermatt. Quand un enfant naît, on fabrique un fromage qui porte son nom; ce fromage est mangé en partie le jour du mariage de cet enfant, on l’achève le jour de ses obsèques. Quand un jeune homme désire épouser une jeune fille, il s’invite à dîner un dimanche dans la famille de sa prétendue: si le père de cette dernière exhibe au dessert le fromage qui porte son nom et lui en donne un morceau, c’est qu’il l’agrée pour gendre.
Allons! voilà une nouvelle noblesse qui ne se trouve dans aucun armorial.
Une noblesse plus héroïque et plus touchante, c’est celle de Guillaume Tell. M. Fiwaz met une chaleur communocative à raconter son histoire. En l’écoutant, je croyais entendre son cœur patriotique et chevaleresque battre du sublime amour de la Patrie. C’est avec orgueil qu’il cite les auteurs qui ont chanté son héros. Il a le roman de Florian, la tragédie de Lemierre, le drame de Schiller, et enfin l’opéra chef-d'œuvre de Rossini.
Guillaume Tell n’a jamais existé, disent certains auteurs: «c’est une légende suédoise transportée en Suisse, c’est un mythe!»
Sceptiques aveugles! la preuve qu’il a existé, c’est l’enthousiasme que son nom éveille. Guillaume Tell a existé comme Jeanne d’Arc, comme tous les libérateurs des peuples; il vit, il vivra toujours, il palpite, il est immortel dans le cœur reconnaissant de l’Helvétie.
Vaud.– Le Grand Conseil s’est réuni lundi soir en session ordinaire d’automne. Il a d’abord liquidé deux interpellations, la première de M. Paul Vulliet relative à la disparition, par suite de travaux exécutés au château de Chillon, des traces de pas de Bonivard autour de la colonne à laquelle il avait été enchaîné.
En réponse à cette interpellation, M. Vicquerat donne lecture d’un rapport du directeur de la restauration.
Ce rapport établit que les traces en question n’ont jamais été creusées par les pas de Bonivard; ensuite que ces traces sont rafraîchies chaque hiver, alors que les étrangers sont peu nombreux, à l’aide de pelles et de pioches, et d’ailleurs ces traces ont été rétablies depuis le dépôt de l’interpellation.
Comme on le voit il est aussi fort bon de raffraîchir l’histoire.